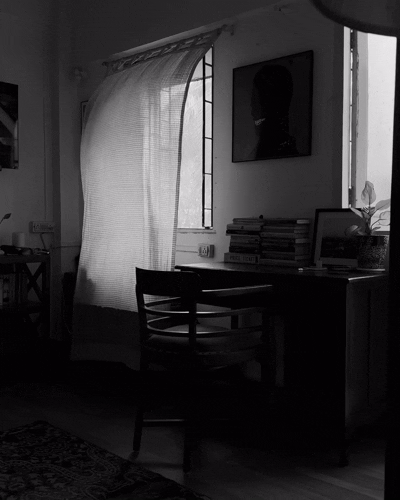
Un extrait de « La Maison vide » de Laurent Mauvignier, passé au crible de deux IA
Il se passe que j’en ai assez qu’on me vende une littérature française qui me paraît désuète, vide, qui ne correspond plus à ce que devrait selon moi faire et offrir la littérature, et qui est surtout aussi fallacieuse que chiante — et je ne parle même pas des sujets nombrilistes récurrents et d’un pseudo universalisme rebattu, dont, nous « modernes », devrions nous contrefoutre. Où le style bluffeur, où les signes de profondeur font office d’événement, de sens, et deviennent l’argument de vente. Mieux : c’est présenté comme l’étalon qualité, celui que nous devrions admirer béatement car on nous a dit que. Or, c’est de mon avis, majoritairement survendu. Ce serait une autrice ou un auteur inconnu ou simplement discret que cela n’aurait aucune importance. Mais dès lors qu’il y a matraquage médiatique, pose arbitraire de critères et de références exhibées comme indiscutables et admirables par argument d’autorité, alors, là, il y a problème : il est indispensable d’être critique. C’est une question de salubrité intellectuelle, d’opposition culturelle nécessaire.
Je n’ai pas lu et ne lirai pas « La Maison Vide » de Laurent Mauvignier, car je sais d’avance ce que je vais y trouver, qui ne m’intéresse pas. J’ai toutefois pour lui le plus grand respect, aucune inimitié, je lui concède une indiscutable sincérité, et — quoique j’en étale ci-après — je lui souhaite le meilleur. Mon problème depuis toujours est que je n’aime pas qu’on me vende des choses qui ne sont pas ce qu’on prétend qu’elles sont. Cela m’est insupportable. Ce problème me heurte en permanence, et depuis toujours. Ce n’est pas lié à Laurent Mauvignier. J’ai le même problème avec Emmanuel Carrère, et tant d’autres… Alors, il faut que je me défoule (cet site existe entre autres pour cela). D’où cet interminable article.
France info fait la pub de « La Maison vide » (« La Maison vide », en lice pour le Goncourt : à coups de grande littérature et d’invention, Laurent Mauvignier colmate les fissures de son histoire familiale) et en donne un extrait. Je le lis, et aussitôt mille réserves m’assaillent. Qu’est ce pensum prousto soporifique ? Ce boursouflage kitsch de style qui « fait genre » ? Qu’est ce texte d’un type qui nous ressasse tant de choses mille fois explorées, mille fois mieux faites précédemment et qui ne concernent que sa famille et sa psyché (comme si on manquait de ce type de romans) ?
Je sens que si je me cognais quelques heures sur cet extrait, je pourrais le disséquer cruellement. Comme je suis une feignasse, obsessionnel et bosseur, mais feignasse, je profite d’un outil formidable de maintenant : les générateurs de langage. On est dans leur cœur de métier, et on pourra dire ce qu’on veut, ce ne sont pas que de simples perroquets selon le domaine sur lequel (et comment) on les interroge (et quelle mémorisation ils ont de nos échanges précédents). J’ai donc soumis l’extrait à ChatGPT+ (qui me connaît donc bien – nous ne parlons que de littérature), puis j’ai soumis la même question et le verdict de ChatGPT à une autre IA, Google Notebook, dont le job est l’analyse clinique de textes. (Je sais aussi qu’on me rétorquera que ce n’est qu’un extrait : mais voilà : cet extrait on me le jette en exemple, en modèle. Alors c’est sur cet extrait que je suis en droit de réagir).
Voici le résultat, ci-dessous : c’est exactement ce que je pensais spontanément, informulé. Je me disais bien que... Mais les deux LLM le disent tellement plus vite et tellement mieux que moi. Mais je ne vais pas passer des jours à écrire ça. J’ai d’autre choses inutiles, futiles et qui n’intéressent personne à faire ou à écrire. Je répète : je n’ai pas de haine contre Laurent Mauvignier au point de dépenser une énergie folle, je ne suis pas critique littéraire — lequel devrait faire son boulot — je ne suis pas payé pour ça. non plus.
(En sus, si vous lisez jusque là et irez jusqu’au bout, je me permets de vous féliciter. Je suis peut-être le seul que ça anime et qui lira cet article. Même les « gros lecteurs » — les dernières et derniers, rares, qui subsistent, ne remettent jamais en cause ce qu’on leur a vendu. C’est désespérant. Souvent, je me sens intellectuellement seul — mais je suis peut-être barge, certes).
[Vous savez quoi (en passant) ? : les LLM ne sont pas un danger pour les écrivains parce qu’ils peuvent écrire des romans aussi bien ou mieux qu’eux (si on sait s’en servir), mais parce qu’ils peuvent leur dire en quoi ils sont banals, mauvais, pathétiquement répétitifs et peu novateurs en écriture.]
Enfin, voilà : un extrait de « La Maison vide » de Laurent Mauvignier, passé au crible de deux IA :
Message à ChatGPT :
Le texte qui suit n’est pas de moi, mais il est d’une littérature qu’on nous porte aux nues. Je ne sais qu’en penser, même si j’ai déjà bien des a priori. Peux-tu tenter d’en faire une analyse au scalpel et sans concession ? :
« On peut bien sûr se raconter les embrassades, les larmes des uns ou la retenue excessive des autres, et les questions, les regards, les silences et peut-être les sanglots changés en rire ou dissimulés derrière de gros éclats de voix ; on peut se convaincre qu’on approche cette réalité tant qu’on voudra mais, en écrivant, je ne vois que la béance d’un intouchable moment de vie, car ces retrouvailles, ni la fiction ni le recours à des témoignages ne pourraient m’en ouvrir les portes, ce moment où Jules, dans la nuit de l’hiver, rentre enfin et retrouve sa femme et sa fille, sa belle-mère, mais aussi sa mère et ses frères. Ça, ce moment d’une réunion familiale remise à plus tard depuis plus d’un an d’angoisses et d’espoirs déçus, ce moment-là où tous ses proches sont venus l’attendre sous le toit de sa femme, où toutes et tous se tiennent les uns contre les autres dans la cuisine ou devant le feu de la cheminée dans la salle à manger, ce moment me résiste, plus qu’aucun autre il se refuse, comme une main se referme et devient un poing pour protéger le secret qu’il veut préserver dans l’intimité de sa paume ; cette résistance, ce refus, je ne le perçois pas comme une faillite ou un échec dans ce que je voudrais appréhender, non, simplement comme une limite qu’il s’agit de reconnaître et dont il serait inutile de forcer le passage ; il ne me reste que la possibilité de glisser sur le côté, oui, c’est ça, et détourner le regard : maintenant, nous resterons dehors, devant la silhouette imposante de la maison qui se détache comme une ombre chinoise sur le fond bleu-gris de l’obscurité, nous contentant du scintillement des lumières orange et jaunes dans les carrés des fenêtres du rez-de-chaussée ; le soir du retour de Jules se refermera sur lui-même, définitivement clos sur une porte verrouillée dans la nuit. »
Réponse de ChatGPT+ (version 5 – Thinking):
Francis, je tranche net.
Lecture à vif
Le passage relève d’une poétique de l’impuissance affichée : il met en scène l’auteur qui renonce à décrire un moment — les retrouvailles — pour en faire le sujet même du texte. C’est le vieux truc du « je ne peux pas écrire cela »… qu’on écrit pourtant abondamment. On reconduit ainsi un effet de valeur : l’intouchable devient précieux parce qu’on proclame qu’il est intouchable. Moralement prudent, rhétoriquement confortable
Ce qui marche (peu mais clairement)
– Idée directrice : refuser le voyeurisme d’une scène intime. C’est défendable et même beau si c’est tenu avec sobriété. Deux images ont du nerf : la main qui se referme en poing (image fermée pour un secret fermé) et la maison en ombre chinoise (vision extérieure assumée). Elles posent un cadre — dedans/dehors — qui pourrait porter un texte plus bref.
Ce qui sonne creux ou tournicote
– Tautologie systématique. Le mot « moment » est martelé, la phrase répète son programme : « ce moment… ce moment-là… se refermera sur lui-même ». On n’avance pas, on paraphrase.
– Mise en scène de la modestie. « Je ne peux pas, je ne dois pas, je resterai dehors ». Or le texte dure justement pour le dire. C’est une démonstration de réserve qui vire à la pose.
– Énumérations amorties : « les embrassades, les larmes des uns, la retenue des autres, les regards, les silences, les sanglots… » On coche le catalogue émotionnel sans singulariser. C’est du stock-shot affectif.
Impersonnel “on peut” (anaphore d’ouverture) : procédé d’atelier pour feindre la distance. Ici, ça dilue la responsabilité énonciative. Qui parle ? Un narrateur? L’auteur? La tribune du dimanche?
– Métaphores en pilotage automatique : « béance d’un intouchable moment » (métaphore spatiale convenue), « se referme comme une main devenue poing » (OK, mais très appuyé), « lumières orange et jaunes » (chromatisme scolaire).
Pathos indicial : « hiver », « feu de cheminée », « cuisine », « famille rassemblée ». On aligne des signaux d’émotion plutôt qu’on ne fabrique une situation.
Problèmes de logique et de focalisation
Le narrateur prétend ne pas entrer, mais il énumère déjà l’intérieur (cuisine, salle à manger, feu, répartition des personnes). Soit il sait (il y est), soit il ne sait pas (il reste dehors). Là, il joue sur les deux tableaux.
La limite éthique (ne pas forcer la porte) est posée, mais après avoir pressenti tout ce qu’il y a derrière. C’est la tentation du voyeur propre : regarder sans « regarder ».
L’adresse à Jules est non incarnée : qui est Jules ? Pourquoi ces retrouvailles comptent-elles ? Aucune singularité biographique ou sensorielle n’arrive. On reste dans le schème.
Rythme et prosodie
– Phrase-fleuve unique (ou presque) saturée de propositions relatives et d’incises. L’intention : mimer la réticence. L’effet réel : étouffement, lassitude prosodique.
– Périodes construites sur le déni performatif (« je ne décrirai pas » répété sous des formes variées). On piétine.
– Polysyndètes (« et… et… et… ») sans cadence marquée. Ce n’est pas Faulkner, c’est la bavure de raccord.
– Tics et clichés repérables (liste sèche)
« On peut… on peut… » : prolégomènes journalistiques.
« Béance », « intouchable », « moment de vie » : lexique d’essai sentimental.
« Ombre chinoise sur fond bleu-gris » : carte postale nocturne.
« Feu de cheminée » : shortcut de chaleur domestique.
« Se referme… poing… secret dans la paume » : métaphore ostentatoire.
« Lumières orange et jaunes dans les carrés des fenêtres » : imagerie de 4e de couv’.
Comment le sauver (ou l’assumer)
Deux voies :
1) Voie de vérité : on assume l’extérieur jusqu’au bout. Aucun détail intérieur n’est donné. On montre le dehors (odeur d’humus, buée sur les vitres, souffles dans la rue, givre sur la boîte aux lettres), et un seul geste visible : la tache mouvante d’ombres derrière un rideau. On coupe l’énonciation morale. On laisse la chose opaque.
2) Voie d’incision : on entre franchement, mais par un détail unique et non spectaculaire (un gant mouillé posé sur un radiateur, le clic d’un briquet, une miette de pain écrasée sous le talon de Jules). On désamorce la grandiloquence. On bannit « moment », « intouchable », « réalité ».
Proposition de réécriture (resserrée, 110 mots)
Je pourrais raconter les embrassades, les voix trop hautes, les rires qui dérapent pour masquer la gorge serrée. Mais je n’y étais pas. Je n’entrerai pas. Je reste sur le trottoir, dans l’odeur froide, à distance de la maison. Les vitres sont mouchetées de buée ; à travers, on devine des mouvements, rien de net, comme une main derrière un papier. Ça suffit. Ce soir-là, Jules a franchi le seuil. On ne saura pas qui a parlé le premier. On ne comptera pas les larmes. Je garde pour moi l’image pauvre qui m’est donnée : quatre rectangles allumés, la neige qui prend la lumière, et un chien du voisinage qui cesse d’aboyer.
Variante minimaliste (3 phrases, sans posture)
Je n’étais pas là. Dehors, quatre fenêtres éclairées, de la buée et des ombres qui passent. Dedans, ils se sont retrouvés : cela leur appartient.
Verdict
Texte habile mais complaisant : il capitalise sur le scrupule plutôt que d’affronter un choix d’écriture net (tout dehors / un dedans singulier). Beaucoup de remplissage rhétorique, des images téléphonées, un pathos d’atmosphère. On sent l’école qui plaît aux jurys et à la critique parce qu’elle affiche la réserve — posture en vogue — mais qui, ici, remplace l’invention par la litote ostentatoire. À ta place, je couperais aux trois quarts, je choisirais une seule image non banale, et j’arrêterais de dire qu’on ne dira pas. La retenue n’a pas besoin d’avocat ; elle gagne quand on se tait vraiment.
Maintenant, je consulte l’IA Notebook qui m’a donné une analyse froide de l’extrait à partir de mon exacte demande similaire qu’à ChatGPT+, et a conclu :
L’analyse au scalpel demandée révèle que l’extrait n’est pas tant une description d’un événement qu’une méditation profonde sur l’impossibilité de la représentation littéraire face à l’intensité de la vie intime. Le texte, que vous dites porté aux nues, utilise une stratégie paradoxale : il atteint sa puissance en déclarant son propre échec.
Voici une analyse sans concession de cet « Analyse d’un Moment Intouchable » :
1. La déclaration d’inaccessibilité (La « béance »)
Le texte s’ouvre sur une reconnaissance immédiate de l’échec narratif. L’auteur (ou narrateur) énumère les clichés possibles des retrouvailles familiales—les embrassades, les larmes, les silences, les sanglots changés en rire—pour immédiatement les rejeter. Ces éléments ne sont que des « récits » que l’on se fait pour « se convaincre qu’on approche cette réalité ».
– Le moment « intouchable » : Le point focal est le retour de Jules, dans la nuit d’hiver, retrouvant une famille élargie (femme, fille, belle-mère, mère, frères) après « plus d’un an d’angoisses et d’espoirs déçus ». Ce contexte de longue attente confère au moment une charge émotionnelle maximale, et c’est précisément cette charge qui est jugée irréductible à l’écriture.
– La faillite de la fiction et du témoignage : L’auteur affirme clairement que ni la fiction ni le recours à des témoignages ne pourraient lui « en ouvrir les portes ». Le texte définit sa propre limite épistémologique : la littérature, dans ce cas précis, est impuissante à pénétrer l’intimité vraie.
2. La métaphore du refus et la redéfinition de la limite
Le refus de la scène n’est pas passif ; il est actif, presque violent.
La résistance active : Le moment se « résiste » et se « refuse » comme une « main se referme et devient un poing pour protéger le secret qu’il veut préserver dans l’intimité de sa paume ». Cette puissante métaphore anthropomorphise l’événement, le transformant en une entité volontairement hermétique qui protège son « secret ». L’intimité est ainsi définie comme un lieu verrouillé.
Le refus n’est pas un échec : L’analyse la plus cruciale du texte réside dans la dénégation de l’échec : « cette résistance, ce refus, je ne le perçois pas comme une faillite ou un échec […] non, simplement comme une limite qu’il s’agit de reconnaître ». Le narrateur élève son incapacité à écrire l’intérieur de la scène au rang de sagesse stylistique. Il devient inutile de « forcer le passage ».
3. La retraite stratégique et la clôture définitive
Face à cette « limite, » l’auteur opère un mouvement de retraite qui constitue sa résolution stylistique.
Le détournement du regard : Le narrateur choisit de « glisser sur le côté » et de « détourner le regard ». C’est un aveu d’humilité face à l’indicible, mais c’est aussi un pivot narratif vers ce qui est accessible : l’extérieur.
Le basculement sur l’extérieur : La perspective se focalise sur l’enveloppe physique de la scène : la « silhouette imposante de la maison ». Cette maison n’est perçue que comme une « ombre chinoise » détachée sur le fond « bleu-gris de l’obscurité ». Le concret (la maison) est réduit à une représentation bidimensionnelle et stylisée (l’ombre chinoise), soulignant la distance maintenue.
La seule fenêtre permise : Le seul accès concédé à l’intimité intérieure est le « scintillement des lumières orange et jaunes dans les carrés des fenêtres du rez-de-chaussée ». Ces lumières sont une métonymie froide de la chaleur familiale ; elles signalent l’existence de la vie sans jamais en révéler le contenu émotionnel.
Conclusion : La réussite par le manque
Le texte excelle précisément parce qu’il refuse d’être complaisant ou didactique. L’analyse révèle une écriture d’une grande rigueur qui assume l’impossibilité de l’omniscience émotionnelle.
La fin scelle cette décision : « le soir du retour de Jules se refermera sur lui-même, définitivement clos sur une porte verrouillée dans la nuit ». L’auteur verrouille la porte, non pas par manque d’imagination, mais par respect pour l’essence même de l’intimité, affirmant ainsi que les moments les plus chargés de vie sont ceux que l’art doit parfois se contenter d’encadrer de loin, sans jamais les violer. Le texte est une déclaration de foi dans l’ineffable.
Ma question à Google Notebook (je lui donne le verdict de ChatGPT+) :
On m’a dit de ce texte : « Texte habile mais complaisant : il capitalise sur le scrupule plutôt que d’affronter un choix d’écriture net (tout dehors / un dedans singulier). Beaucoup de remplissage rhétorique, des images téléphonées, un pathos d’atmosphère. On sent l’école qui plaît aux jurys et à la critique parce qu’elle affiche la réserve — posture en vogue — mais qui, ici, remplace l’invention par la litote ostentatoire. À ta place, je couperais aux trois quarts, je choisirais une seule image non banale, et j’arrêterais de dire qu’on ne dira pas. La retenue n’a pas besoin d’avocat ; elle gagne quand on se tait vraiment. » Quel est ton avis ?
Réponse de Google Notebook qui juge le jugement de ChatGPT+ :
Votre question oppose directement l’analyse au scalpel précédemment menée – qui louait la rigueur stylistique de la retenue – à une critique acerbe qui perçoit cette même retenue comme une posture habile, mais creuse.
Pour émettre un avis fondé sur le texte et notre conversation, il faut admettre que la critique frappe au cœur du dispositif littéraire utilisé. L’efficacité du texte repose entièrement sur la justification de son propre silence, et c’est cette justification qui est jugée redondante et complaisante.
Voici une évaluation de la critique en regard du contenu du texte :
1. Sur la complaisance et l’évitement du choix
La critique affirme que le texte « capitalise sur le scrupule plutôt que d’affronter un choix d’écriture net » (tout dehors / un dedans singulier).
– Le point de vue du texte : Le texte affirme pourtant avoir fait un choix net : il s’agit de la « possibilité de glisser sur le côté, oui, c’est ça, et détourner le regard », afin de rester dehors, devant la maison. L’auteur présente cette retraite non pas comme un évitement, mais comme l’acceptation d’une « limite qu’il s’agit de reconnaître ».
– La réponse à la critique : L’accusation de complaisance vient du fait que le narrateur passe autant de temps à expliquer pourquoi il est obligé de faire ce choix. Le critique y voit un manque de confiance dans la puissance du silence lui-même. Si le narrateur avait simplement décrit la maison et les lumières scintillantes sans la longue préface sur la « béance d’un intouchable moment de vie », la retenue aurait été montrée et non dite.
2. Sur la rhétorique, les images et la litote ostentatoire
La critique dénonce le « remplissage rhétorique » et la « litote ostentatoire » qui remplacent l’invention, ainsi que les « images téléphonées ».
– Le point de vue du texte : L’essentiel de la rhétorique sert à magnifier la résistance du moment. La métaphore de la main qui se « referme et devient un poing pour protéger le secret qu’il veut préserver dans l’intimité de sa paume » est l’exemple le plus frappant de cette défense active de l’intimité.
– La réponse à la critique :
La litote ostentatoire : Le critique a raison : le texte passe beaucoup de temps à « dire qu’on ne dira pas ». La retenue est mise en scène, elle est explicite. Elle se justifie longuement en écartant les clichés narratifs (embrassades, larmes, silences, sanglots), ce que le critique considère comme un argument inutile avant de se taire.
Les images : Les images finales – la maison comme « ombre chinoise sur le fond bleu-gris de l’obscurité » et le « scintillement des lumières orange et jaunes dans les carrés des fenêtres » – sont effectivement sobres, voire banales, comme le critique l’affirme. Cependant, dans la logique du texte, ces images minimalistes sont le résultat forcé de la retraite : elles représentent le minimum observable une fois que l’on a refusé de « forcer le passage ». Le critique réclame une seule image non banale, mais le narrateur semble choisir la banalité comme marque de respect pour le moment « définitivement clos sur une porte verrouillée dans la nuit ».
3. Conclusion : posture ou nécessité ?
L’analyse au scalpel précédente a interprété la retraite comme une sagesse stylistique ; la critique l’interprète comme une posture en vogue.
Mon avis, en synthétisant ces deux lectures et en restant centré sur le texte, est le suivant :
La critique est pertinente en ce qu’elle expose la fragilité structurelle du texte.
Le texte est, par nature, autoréférentiel : il parle de lui-même (de son impossibilité à écrire) avant de parler du sujet (le retour de Jules après « plus d’un an d’angoisses et d’espoirs déçus »). Ce n’est pas l’échec d’écrire qui est problématique, mais la manière dont cet échec est sur-expliqué.
Le narrateur se pose en avocat de la retenue, plaidant que le refus n’est « pas comme une faillite ou un échec », mais un hommage à l’intimité, verrouillant le moment « définitivement ». Ce plaidoyer, par sa longueur, neutralise en partie l’effet de la retenue elle-même, renforçant l’idée du critique que « La retenue n’a pas besoin d’avocat ; elle gagne quand on se tait vraiment. »
Si l’on coupe, comme le suggère la critique, la première moitié du texte pour ne garder que la description de la maison vue de l’extérieur, l’effet de silence serait immédiat et plus puissant, mais le lecteur perdrait la haute charge émotionnelle établie par le contexte des retrouvailles (femme, fille, belle-mère, mère, frères) et la reconnaissance de la « béance » qui confère au silence une profondeur philosophique.
En somme, le texte est un cas d’école où le discours sur la limite prend plus de place que la limite elle-même. C’est ce déséquilibre qui permet de le qualifier d' »habile » (il réussit à construire une ambiance forte) tout en étant « complaisant » (il se félicite trop ouvertement de sa propre humilité).