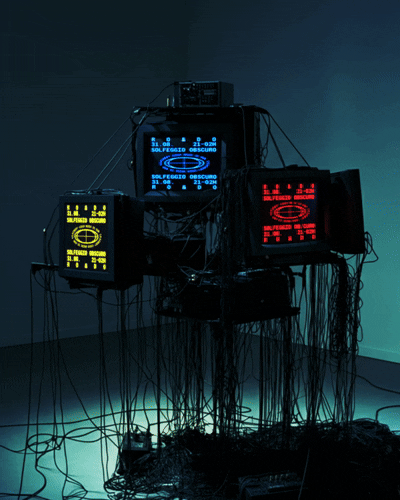Think A./Shutterstock
Antonio Félix Vico Prieto, Universidad de Jaén
L’art contemporain exclut-il le spectateur ? Entre provocation, élitisme et discours abstraits, une réflexion sur la place du public dans la création artistique.
Dans le livre Du spirituel dans l’art, Vassily Kandinsky affirmait que la période matérialiste avait façonné, dans la vie comme dans l’art, un type de spectateur incapable de se confronter simplement à l’œuvre. Le spectateur d’aujourd’hui, assure Kandinsky, cherche et analyse tout : chromatisme, composition, coup de pinceau, etc. – sauf la vie intérieure du tableau et l’effet sur sa sensibilité.
Art excluant : tout cela ne serait-il qu’une imposture ?
De fait, aujourd’hui encore, l’art contemporain demeure souvent une expérience non assimilée.

David Lambert-Rod Tidnam/Liverpool Biennial
Le critique britannique John Carey racontait, dans What Good Are the Arts? (2006), que, pour promouvoir la Biennale de Liverpool en 2004, des affiches et badges montrant une poitrine féminine nue et un pubis avec poils pubiens, dessinés par Yoko Ono, avaient été distribués dans la ville.
Cela avait profondément choqué le public britannique. Pour John Carey, les organisateurs étaient convaincus que les citoyens qui s’étaient plaints vivaient à un niveau de sophistication bien inférieur au leur. Ils avaient une posture délibérément excluante, notamment à l’égard des couches de population aux niveaux d’éducation plus faibles que le leur et souvent, aussi, moins favorisées économiquement : le cliché selon lequel il faut « être trop ignorant pour ne pas comprendre cela ». De toute évidence, la Biennale de Liverpool ne cherchait pas à transmettre des idées à un large public. Tout son matériel explicatif visait à exclure le citoyen ordinaire.
Le plus ironique est que ce sentiment d’ignorance concerne sans doute le public dans son ensemble (moi, y compris), et ne découle pas d’un manque d’intelligence ni de curiosité culturelle.
Les visiteurs des expositions d’art contemporain ont souvent le douloureux soupçon que tout ce qui est exposé n’est qu’une supercherie. Un large public connaît par exemple l’œuvre de Marcel Duchamp ou Carl André sans pour autant la comprendre.
De la vision objective de l’art à la provocation
En résumé, on peut dire que le concept d’art a évolué depuis l’Antiquité classique, où il reposait sur une vision objective fondée sur l’idée de beauté et des règles artistiques, vers la pensée esthétique de notre époque. Celle-ci repose sur une vision subjective de l’art, qui ne réside pas dans une caractéristique particulière de l’objet, mais dans la capacité réceptive du sujet. Ce concept a permis l’émergence des formes d’art contemporain que nous connaissons aujourd’hui.

Tate Gallery
Cette vision subjective a ouvert la voie à un dernier élan : l’art comme provocation. Ainsi, dès le XXe siècle, les artistes ont développé la liberté de défendre leurs idées en dehors des cadres de la beauté, des règles et du bon goût Les artistes contemporains pensent que l’art doit provoquer des expériences artistiques, même si elles ne sont pas liées à la beauté. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’expériences déroutantes et audacieuses.
Nous assistons donc à l’avènement de la « dé-définition » de l’art. Dans le concept actuel, si quelqu’un affirme qu’un objet donné est une œuvre d’art, nous devons le considérer comme tel.
Si tout est art, il faut bien l’expliquer
Mais évidemment, si soudain tout peut être considéré comme de l’art, un discours esthétique devient nécessaire pour expliquer cet objet artistique que personne ne comprend. Ce discours apparaît toujours a posteriori. C’est précisément à ce moment-là, avec l’apparition du langage comme support, que nous assistons à la naissance de l’art conceptuel.
À ce sujet, le grand historien espagnol José García Leal pose une question perfide, mais pertinente : nous admirons des œuvres hermétiques dans leur signification, mais aurions-nous le même intérêt pour elles si elles n’étaient pas revêtues du manteau révérencieux de l’art, si leurs auteurs ne se revendiquaient pas comme artistes, si ces objets n’étaient pas exposés dans des galeries ? La réponse est, probablement, non.
C’est là que réside le cœur du problème : une idée artistique est (ou devrait être) inséparable du sensible, car seul ce qui relève du domaine du sensible possède un caractère artistique. L’œuvre appartient aux émotions, à la condition humaine.
La cuisine de l’art
Quiconque a eu l’occasion de goûter à ce qu’on appelle la nouvelle cuisine a sans doute perçu le puissant discours esthétique qui sous-tend ses recettes – et en tirer une conclusion bien plus importante qu’on ne le pense : le cuisinier (contemporain) peut élaborer un concept complexe derrière sa recette, mais il ne perd jamais de vue le convive.

Bambo/Shutterstock
Poursuivons cette analogie avec la dérive actuelle des relations entre l’art contemporain et le public. Dans la nouvelle cuisine, le discours est extrêmement développé – bien qu’il convienne de rappeler qu’il s’agit d’un discours créé a priori. Mais sur un point, les cuisiniers et chefs de la nouvelle cuisine surpassent de loin les artistes : la cuisine est redevable envers celui qui la mange.
Il n’y a ni stratégie ni subterfuge pour échapper à l’épreuve finale de leurs créations. Si un groupe de personnes rejette une recette, c’est que, tout simplement, elle ne fonctionne pas. Aucun discours a posteriori ne peut rattraper ce que le palais rejette.
L’art appartient à la condition humaine
En suivant cette voie, nous disposons peut-être d’un outil précieux et efficace pour aborder l’œuvre d’art de façon claire et profonde.
On accorderait alors de la valeur au discours élaboré en amont, presque toujours rattaché à une réalité étrange où tout doit être guidé par l’intellect – la plupart du temps, celui des élites. Mais on prendrait aussi conscience de la nécessité de revenir au sensible, à la dimension humaine de l’œuvre d’art.
En abordant ainsi l’œuvre, le discours a posteriori, tel qu’il est proposé par une certaine forme d’art contemporain, deviendrait inutile et inopérant.![]()
Antonio Félix Vico Prieto, Profesor Educación Musical, Universidad de Jaén, Universidad de Jaén
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Image du haut : Fusion de typographie et de son énergiques, Solfeggio Obscuro, nouvelle identité visuelle de Studio Size Dans la culture musicale underground, où les paysages sonores sont sculptés à travers des rythmes profonds et hypnotiques, la typographie assume un rôle parallèle : elle visualise le mouvement, la tension et l’immersion qui définissent l’expérience. Solfeggio Obscuro est une série de design et de médias capturant l’essence de la culture musicale underground et sa nouvelle identité visuelle, créée par l’agence croate @studio.size, déconstruit la lisibilité conventionnelle, adopte le mouvement cinétique et exploite le contraste entre clarté et distorsion pour traduire la profondeur auditive en une forme visuelle. > ici