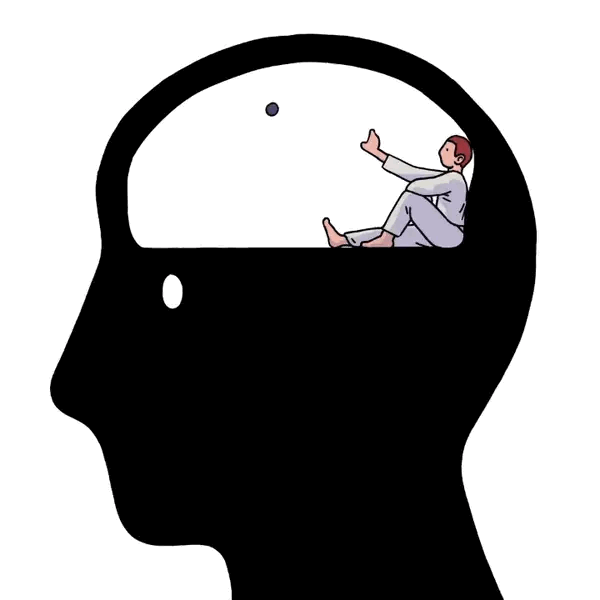
On reçoit parfois des textes étranges de gens qui se prennent la tête
L’écriture, le désir d’écrire, le besoin d’écrire, le mythe de l’écrivain…, tout cela peut souvent mener nombre d’entre nous à quelque peu s’oublier. On le sait : il suffit de dire que vous êtes écrivain et en face, tout de suite, il y en a qui déboule en vous disant que lui aussi écrit ou voudrait écrire (dans ce pays où il y a mille fois plus d’écrivants que de lecteurs).
Cela faisait très longtemps que je n’avais pas reçu de courriels bizarres écrits par des personnes exaltées. (Une fois, il y a une quinzaine d’années, j’ai même reçu par la poste un gros dossier de textes inintelligibles agrémentés de coupures de journaux, de collages d’images bizarres qui me menaçait de je ne sais plus quoi parce que j’écris des livres).
Ce 22 octobre 2025 à 19h22, un courriel d’un certain « Anonymo » m’est parvenu (j’ai attendu avant de le publier ici), envoyé en parallèle à l’écrivain François Bon. Dites-vous que je reçois ce genre de texte alors je ne suis qu’un auteur mineur, désormais peu connu et quasiment oublié… Je n’ose pas imaginer ce que doivent recevoir les écrivain.es en vue, les stars de cinéma, de télé, de théâtre, les chanteurs, musiciens vedettes… Bref, les célébrités.
Le courriel de « Anonymo » (et je ne sais qu’y répondre…) :
Je ne vous cache pas que je vais à la pêche.
Pas de panique. Je ne vais pas vous demander des conseils ou de m’insérer dans un réseau. Trop fier, sans doute.
J’écris. Ô surprise !
Mais voilà, je ne suis pas l’auteur régulier qui se lève à 4 heures du mat’ tous les jours avec une coupe de champagne aux lèvres. Pas cette chance.
J’ai passé plus de temps à faire croire que j’étais un idéaliste altruiste et à me mettre dans les veines toutes sortes de saloperies, que je payais en avalant toutes sortes d’autres fluides.
Bref, je déteste Bukowski.
Moi, je crois en la littérature.
Pas aux éditeurs. J’ai flairé le truc après avoir lu Dicker, à qui on suçait la bite à longueur d’émission pour une valeur littéraire quasi nulle.
Bref.
Je suis un écrivain polyphonique. Je ne veux pas ressembler à ça :
Benoît avait bien arrangé sa table de travail. Il avait jeté au sol la plupart des papiers qui l’encombraient — des factures impayées et des relances en grande quantité —, placé un unique stylo-plume et des centaines de cartouches d’encre, cinq ramettes de papier blanc de la meilleure qualité dont l’une avait été ouverte.
En bonne place, une pile d’une centaine de feuilles immaculées attendaient bien sagement d’être couvertes de son écriture et, bien entendu, un gros carton rempli de beignets au chocolat — il avait tenté les cigarettes un jour plus tôt mais il trouva que cela modifiait trop le goût de ses aliments favoris : la glace à la vanille et aux noix de pécan, par exemple.
Fin prêt.
Paré à l’abordage de la Grande Littérature. Paré à devenir une légende du stylo qui cisèle des histoires génialissimes, à double voire triple lecture, aux thèmes extraordinaires, au style flamboyant à vous en brûler les yeux… Le génie, quoi !
Mais bon, il faut d’abord trouver l’idée. Celle qui met à mort toutes les autres pour enfin donner au monde une parcelle — certes infime, mais brillantissime de son intelligence supérieure. Il voyait déjà son nom imprimé en lettre d’or sur les journaux, s’imaginant les interviews radiophoniques et télévisées (surtout la télévision, Benoît adorait la télévision).
« Alors, Mr Croniaud, dites-nous tout. Comment vous est venue l’idée de ce roman, sans conteste l’une des plus grandes réussites de ces dernières décennies ?
— Ah, cher monsieur Poivre : le génie. L’intelligence et le génie, voilà tout ! »
Le génie, oui. Mais bon. D’abord l’idée.
« Voyons », se dit-il à lui-même.
Il scruta la feuille blanche, comme le sculpteur cherchait la forme dans le marbre. Peut-être le texte était-il déjà inscrit sur la feuille avant même que le stylo se pose sur celle-ci.
L’idée lui plaisait. Il approcha son visage du blanc de la pile de feuilles et l’examina avec la plus grande attention.
Peut-être que…
Non. Ça ne fonctionnait pas.
Il se redressa contrit.
« Merde ! », fit-il, « Merde de merde de merde de merde !!! »
Il leva sa grosse paluche boudinée et velue puis se saisit d’un beignet qu’il mordit goulûment.
Une flaque de chocolat s’échappa de l’énorme morceau qu’il avait en bouche et s’écrasa sur la page blanche.
« Me’de ! », fit-il, « Me’de de me’de de me’de de me’de !!! »
Il mastiqua d’émotion.
Il reposa le beignet qu’il avait dans la main et roula en boule cette première page avant de se rendre compte que la suivante luisait déjà de la graisse qui maculait ses doigts.
Quand il s’en aperçut, il s’arrêta net. Il leva les yeux au ciel en gémissant et se leva. Il ouvrit la porte de sa chambre et tomba nez à nez avec la cuisine de sa studinette.
Il se lava les mains méticuleusement et revint dans sa chambre. Il roula en boule le fichu papier et l’envoya dans la corbeille où l’attendait l’autre.
Il remarqua que la feuille suivante, elle aussi, avait de belles taches de gras. Il observa l’ennemi : cette marbrure huileuse qui tranchait avec la blancheur du papier de la meilleure qualité qui lui avait coûté la peau du cul.
« MERDE ! », cria-t-il, « MERDE DE MERDE DE MERDE DE MERDE !!! »
Il prit la liasse et la jeta à la poubelle. Il s’assit à son bureau et mangea le restant de son beignet.
Il mastiqua un autre beignet, laissant s’échapper des filets de chocolat sur la table. Il enfourna dans sa bouche un autre beignet et rêvassa. Il imaginait une belle plage avec des noirs en costumes tribaux dansant autour d’un feu — ce serait la nuit. On apporterait une énorme marmite de fonte avec, flottant entre les différents légumes dans un bouillon, une ravissante femme. Il voyait une armée coloniale menée par le petit ami de cette délicieuse nymphe, embusqué derrière des buissons, fusil au poing — Ô Merveille ! Quelle histoire ! — Et là, un suspense effrayant : des lions arrivent derrière eux et rugissent — Du génie, du pur génie ! Il pourrait parler de la misère culturelle africaine, de la grandeur du colonialisme et des rondeurs de l’héroïne. Il vit qu’il pouvait, avec cette idée, donner une ambiance quasi fantastique (dring) et faire contraste entre l’homme civilisé et la nature hostile et parler de l’instinct (dring) en chacun de nous…
Du génie. Une notion qui pourrait parler à l’humanité entière et lui valoir le prix (dring) Nobel… Oh oui ! Oh oui ! Le prix Nobel !
DRING
La sonnerie du téléphone fit faire à son esprit une chute brutale qui s’amplifia à la vue de tout le chocolat qui lui maculait le pantalon (dring).
« Merde ! », dit-il, « merde de (là, il se leva ; le chocolat tombait en gouttes sur la moquette [dring] alors qu’il allait vers le téléphone) merde de merde !!! »
Il décrocha, légèrement enragé :
« ALLÔ OUI !
— Bah Benoît ? Qu’est-ce qu’il t’arrive, dit une petite voix étonnée, tu t’es encore énervé tout seul mon petit bout ?
— Ah Rose… Excuse-moi, j’étais en train d’écrire.
— Et ça va bien ?
— Merveilleux, Rose, MER-VEIL-LEUX ! Je n’ai jamais été si bon, dit Benoît en se léchant les doigts recouverts de chocolat.
— Tu crois qu’on pourrait se voir ce soir ? Ça fait si longtemps et… (elle chuchote presque) J’ai terriblement envie.
— Ah oui ? Enfin, Rose, enfin ! Tu sais bien que je préfère garder toute mon énergie quand j’écris, ma petite loutre. Surtout mon énergie sexuelle. C’est IN-DIS-PEN-SABLE ! J’ai lu ça quelque part où il faisait le parallèle entre l’éjaculation et la sortie de l’encre du stylo à plume de l’écrivain romantique (en disant cela, il eut l’impression que le téléphone devint gluant, il comprit quand il vit le chocolat fondu entre ses doigts et le combiné).
— Ah ! »
Il y eut un silence. Benoît ne s’en rendit pas compte tant il était occupé à lécher les doigts chocolatés de son autre main en pensant qu’il lui faudrait certainement lécher le combiné avant de poursuivre la conversation philosophique qu’il entretenait avec la charmante Rose.
« Et quand pourra-t-on se voir, alors ? demanda-t-elle, inquiète.
— Hum mmm, mmm (sa langue était occupée à lécher le combiné du téléphone)
— Quoi ?
— Je disais : je travaille, moi !
— Bah ! N’importe quoi ! T’es au chômage, mon bichon ?
— Je te parle d’un travail bien plus important que ces postes sans envergure proposés par ces entreprises esclavagistes. Je te parle d’art. Je te parle de ma prose. Je te parle de mots qui pourraient bien changer la face du monde, ma pauvre amie ignorante.
— Ah oui ! Au fait, en parlant de ça ! Tu as enfin changé tes draps ? Parce que j’en ai acheté au cas où…
— Rose ?
— Oui ?
— Tu m’emmerdes ! »
Il raccrocha, soulagé de ne plus avoir à parler des bassesses matérielles de ce monde… Changer les draps !!!
Il alla quand même en vérifier l’odeur, et il prendrait bien un petit beignet, comme ça, en passant.
Le téléphone sonna de nouveau alors que Benoît léchait les draps tachés de chocolat (maudit beignet !) — Et Rose avait raison, les draps sentaient mauvais.
Il courut vers le téléphone, furieux qu’on le dérange en plein travail créatif (lécher laissait libre cours à son imagination débridée). Il décrocha.
« Tu vas me foutre la paix, Rose ! À moi et à mon éjaculation créative, bordel de Dieu !
— Ne jure pas, mon bébé, ne jure pas ! fit une voix de femme autoritaire.
— Maman ?
— Elle-même !
— Ça… ça va ?
— Oh ! Tu sais, il y a mon arthrite qui me fait bien souffrir, mes yeux ne voient plus très bien, j’ai mal aux jambes et je crois bien que j’ai des hémorroïdes, sans parler de ton père qui entretient au mieux ma dépression… Sinon, ça va.
— Et papa ?
— Une petite crise cardiaque, sans plus ?
— QUOI ?
— Ne t’inquiète pas, mon ange, ton père va bien. Trop bien même… Figure-toi que ça ne l’empêche absolument pas d’être toujours aussi épouvantable avec moi…
— Il est à l’hôpital ?
— Oh non ! Et puis ça s’est passé il y a deux mois. On n’a pas voulu te prévenir pour ne pas que tu t’inquiètes. Je m’inquiète, moi, quand tu t’inquiètes. Ça me déprime encore plus (elle sanglote). Et tu ne voudrais tout de même pas que ta pauvre mère aggrave sa dépression. C’est déjà tellement dur avec ton père, mes hémorroïdes et tout ça.
— Oh maman ! Je suis désolé.
— Oui. Bah tu peux. À m’avoir laissée seule avec ce grand connard qu’est ton père. Et sinon, toi, ça va ?
— Oui, oui, ça va. Je travaille.
— C’EST VRAI ?
— Je travaille à mon livre.
— Ah !
— Oui !
— Le livre.
— Voilà.
— Rappelle-moi. Tu l’as bien commencé à 12 ans, ce livre ?
— Oui.
— Et tu as quel âge aujourd’hui ?
— Quarante ans. Oui, mais bon, Maman. Ces choses-là ne sont pas à prendre à la légère, tu sais.
— Des clous ! T’es un abruti comme ton père ! Pourquoi tu ne trouves pas un bon petit travail, que tu n’épouses pas une gentille fille et que tu ne me fasses pas un beau petit-fils ? Tu veux faire mourir ta pauvre mère, c’est ça ?
— Maman ! fit Benoît, laissant traîner la dernière syllabe.
— Prends pas ton air condescendant, imbécile, ou je te déshérite… Fils ingrat. T’es invité à manger à la maison ce week-end… Pour ton anniversaire.
— Mais maman, je travaille sur…
— JE M’EN FOUS, BENOÎT ! Tu viens, un point c’est tout, à treize heures samedi. Je pourrais avaler toute ma boîte de somnifères si tu oses ne pas venir.
— Mam…— Tut ! Pas de ce ton-là avec moi. Et habille-toi bien. À samedi… »
Benoît entendit le combiné s’éloigner de la bouche de sa mère avec soulagement. Soudain :
« ET BON ANNIVERSAIRE, FILS D’IMBÉCILE ! »
Et elle raccrocha.
Voilà.
En ce moment, j’écris en dilettante un polar. Style :
« Il aimait les étoiles. »
Son regard est sec, vide, terne. Il voit au-delà de sa tasse de café, loin dans le passé.
« Putain ! Dit comme ça, ça a l’air con. Mais c’était vraiment son truc. On l’a gardé longtemps, son télescope. Je ne sais pas où il a atterri. Peut-être dans un carton, quelque part. Je ne sais pas. — Vous l’aviez acheté finalement ? »
Ses yeux luisent. Un tremblement dans la voix, léger.
« Il économisait depuis des mois pour ce télescope. Ce cadeau, on a décidé qu’on devait le faire. Même si c’était le seul qu’il devait y avoir sous le sapin. »
Il soupire.
« Moi, j’en ai rien à foutre des étoiles. Ce que m’a appris Tahar, c’est la Grande Ourse, la Petite Ourse et l’Étoile Polaire. J’avoue que je l’écoutais à moitié. J’étais plutôt football. Je me demande maintenant s’il ne s’y est pas mis pour me faire plaisir. »
Un sourire fugace avant qu’il ne fronce les sourcils.
« Tout le monde adore les années 80… Pas moi. On nous traitait de bicots. Les gendarmes étaient limites. Un Arabe de plus ou de moins… Je suis passé entre les gouttes : mon père voulait absolument m’appeler Gilles. »
Silence.
« Les gendarmes ont dit qu’il avait fugué. Son cartable, on l’a retrouvé derrière l’épicerie. Il voulait me faire une surprise et me rejoindre à la gare. Il a voulu faire du stop. Il avait 13 ans. C’était le 7 novembre 1985. »
C’est le genre de trucs que je fais dans mon coin.
Mais en ce moment, j’écris un truc fiévreux, dense et cohérent, de sa conception à sa publication.
Pour l’écrire, j’ai bazardé tous les parasitages comme les amis ou la famille. J’ai besoin de parler avec des adultes de cuisine, de structure, de rythme.
Je travaille à l’os, je densifie et je rabote tout effet de style pour atteindre une parole pure, celle d’un gamin enragé qui n’a pas forcément une grammaire affûtée.
Mais par contre, derrière, j’utilise toutes les techniques de manipulation (explosion du fusil de Tchekhov, jeu avec les clichés et avec les attentes, tout en respectant la forme classique de la tragédie grecque).
Invendable, quoi.
Mais je me fais chier à l’écrire, à le polir, à descendre dans la mine pour retrouver la rage d’antan, celle qui vous file un ulcère et vous fait cracher du sang.
Je veux arracher des morceaux de réel.
Et j’ai juste besoin de savoir qu’il y a des gens qui savent ce que c’est.
C’est tout.
En espérant que ce mail vous aura diverti.
C’est un mail commun à François Mizio et à François Bon. Je lirai vos livres un de ces quatre, promis. Faut juste que je m’en tape quelques-uns pour ce que je fais.
Ah oui, je suis anonyme.
C’est mieux. Le sujet du livre et les détails me mettent en danger, donc je vais éviter de trop m’épancher sur le personnel. J’utilise un compte Gmail dédié pour cette correspondance. Je mettrai sans doute du temps à répondre.
Deux jours plus tard, envoyé à 4h53, ce message :
Bonjour,
Je suis désolé de vous avoir dérangé. Tout cela n’a plus aucune importance.
Merci du temps que vous m’avez accordé.
Prenez soin de vous, la vie est courte.
La lune, cette nuit, s’est cachée.