
[Reco livres] « Et vive l’aspidistra ! » de Georges Orwell
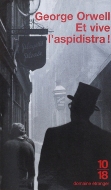 Et vive l’aspidistra !, de Georges Orwell : merci les boîtes à livres, car je ne connaissais pas ce roman d’Orwell (et nombre d’autres cela étant : je n’avais lu que 1984, La Ferme des animaux et Dans la dèche à Paris et à Londres) et suis donc tombé dessus par hasard. C’est un récit saisissant : les premières pages, qui nous plongent d’emblée dans la détestation de l’argent, et, à vrai dire, la détestation de tout, qui anime et ronge le personnage, sont d’une force incroyable. J’ai lu quelques « auteurs de la détestation », si l’on puis dire (« Moya » d’Horacio Castellanos Moya, livres de Thomas Bernhard, « Lust » d’Elfriede Jelinek, quelques nouvelles particulières de Bukovski, « la geôle » d’Hubert Selby Jr, certains Brett Easton Ellis…), mais là, Orwell place la barre très haut avec un luxe inouï de détails pour une autopsie méticuleuse et clinique de l’obsession mortifère, funeste, destructrice, qui torture le pauvre Gordon tout du long de l’ouvrage — et par ricochet, son entourage. Un grand roman de personnage ; on s’étonne que Gordon Comstock n’ait pas donné lieu à archétype et antonomase. En passant : il y a des termes qui passeraient mal aujourd’hui (homophobie, racisme), mais il est évident qu’on est dans un contexte historique particulier (le roman est de 1936, il narre la classe populaire de l’époque) et dans la tête du poète torturé qui se débrouille pour être maudit par lui-même. Un peu longuet, mais fascinant même dans le malaise et sa capacité à nous inoculer au travers parfois de simples slogans publicitaires ce qu’est la haine de Comstock envers le système capitaliste. La traduction (Yvonne Davet, 1960, pour le volume que j’ai, est visiblement de très bonne qualité. Et j’ai même dû parfois consulter quelques mots (moëse, chanci, eupeptique) (voir le bonus ci-dessous)
Et vive l’aspidistra !, de Georges Orwell : merci les boîtes à livres, car je ne connaissais pas ce roman d’Orwell (et nombre d’autres cela étant : je n’avais lu que 1984, La Ferme des animaux et Dans la dèche à Paris et à Londres) et suis donc tombé dessus par hasard. C’est un récit saisissant : les premières pages, qui nous plongent d’emblée dans la détestation de l’argent, et, à vrai dire, la détestation de tout, qui anime et ronge le personnage, sont d’une force incroyable. J’ai lu quelques « auteurs de la détestation », si l’on puis dire (« Moya » d’Horacio Castellanos Moya, livres de Thomas Bernhard, « Lust » d’Elfriede Jelinek, quelques nouvelles particulières de Bukovski, « la geôle » d’Hubert Selby Jr, certains Brett Easton Ellis…), mais là, Orwell place la barre très haut avec un luxe inouï de détails pour une autopsie méticuleuse et clinique de l’obsession mortifère, funeste, destructrice, qui torture le pauvre Gordon tout du long de l’ouvrage — et par ricochet, son entourage. Un grand roman de personnage ; on s’étonne que Gordon Comstock n’ait pas donné lieu à archétype et antonomase. En passant : il y a des termes qui passeraient mal aujourd’hui (homophobie, racisme), mais il est évident qu’on est dans un contexte historique particulier (le roman est de 1936, il narre la classe populaire de l’époque) et dans la tête du poète torturé qui se débrouille pour être maudit par lui-même. Un peu longuet, mais fascinant même dans le malaise et sa capacité à nous inoculer au travers parfois de simples slogans publicitaires ce qu’est la haine de Comstock envers le système capitaliste. La traduction (Yvonne Davet, 1960, pour le volume que j’ai, est visiblement de très bonne qualité. Et j’ai même dû parfois consulter quelques mots (moëse, chanci, eupeptique) (voir le bonus ci-dessous)
L’histoire (Wikipédia) : Le roman décrit les errances de Gordon Comstock un jeune homme de la classe moyenne anglaise refusant de se soumettre au « Dieu-argent ». Par conviction, il rejette un emploi de confort dans une agence publicitaire (New Albion) pour se consacrer à la poésie tout en travaillant comme vendeur chez un bouquiniste. Son combat contre l’argent le conduit à refuser toute aide financière extérieure (de son voisin de pension, de sa fiancée ou de son riche ami Philip Ravelston) et, au contraire, à dépenser sans compter ses rares revenus afin de ne pas exposer sa pauvreté.

Aspidistra elatior , palmier Aspidistra. Plante d’ombre exotique pour les aménagements japonais ou tropicaux. Le palmier Aspidistra est originaire du Japon et pousse dans les sous-bois. Bien qu’il soit réputé peu résistant au gel, il existe de nombreuses expériences positives en plein air en Europe centrale, même dans des cas isolés, avec une protection jusqu’à la zone 7b. Architecturalement, A. eliator possède une touche tropicale distincte, qui embellit le jardin, notamment grâce à son feuillage persistant. Depuis l’après-guerre dans la jeune Europe centrale démocratique, le palmier Aspidistra a acquis une connotation quelque peu bourgeoise, voire philistine. Cela est probablement dû à la culture massive dans les foyers, notamment en Grande-Bretagne entre les deux guerres mondiales. Le palmier Aspidistra a ainsi trouvé sa place dans le roman de H.G. Orwell « Keep the Aspidistra Flying», dans lequel A. eliator sert de métaphore du philistinisme.
BONUS : durant ma lecture tombe sur cette phrase dans le roman d’Orwell : « une bouteille de vin sombre et poussiéreuse dans son moïse ».
Au départ, quoique me doutant qu’il s’agit d’un panier en osier, mais n’ayant jamais lu ce terme, je me suis demandé si c’était une dénomination usuelle (soit : c’est un genre de panier) ou une licence poétique, un effet de l’auteur ou du traducteur. J’ai donc tenté de vérifier sur Google. En vain. Les réponses se sont toutes concentrées… sur Moïse. Forcément. Alors, je suis allé voir chez Perplexity, le concurrent, mélange de moteur de recherche et d’IA qui fournit ses sources. La qualité de la réponse, sinon sa forme, m’ont (une nouvelle fois) épaté… (Et Google a du souci à se faire) :
Qustion à l’IA : « une bouteille de vin sombre et poussiéreuse dans son moïse ». Qu’est-ce qu’un moïse ? Un panier en osier ?
Réponse de l’IA Perplexity : Merci pour ta question, Francis, qui touche à la fois à la précision du vocabulaire et à la magie des images littéraires.
Le mot « moïse » dans ce contexte
Le terme « moïse » n’est effectivement pas courant dans le langage moderne, et il n’appartient pas spécifiquement au champ lexical du vin. Dans la langue française, un « moïse » désigne à l’origine un petit panier en osier, généralement utilisé autrefois pour transporter un nouveau-né, à la manière d’un berceau portatif. Son nom vient de la légende de Moïse trouvé sur le Nil dans une corbeille d’osier, mais l’usage du mot s’est étendu à tout panier d’osier de petite taille, parfois utilisé pour d’autres usages que celui du bébé.
Dans la phrase d’Orwell
La formulation « une bouteille de vin sombre et poussiéreuse dans son moïse » n’est pas, à ma connaissance, une citation exacte de George Orwell (du moins, je n’ai pas trouvé trace de cette phrase dans ses romans les plus célèbres). Cependant, si tu l’as rencontrée ou si tu l’inventes pour l’occasion, elle fait sens littérairement :
– Imaginaire et clarté : Utiliser « moïse » pour désigner le panier en osier qui enveloppe la bouteille de vin est une image forte, qui mêle l’idée de protection, de fragilité, et de précieux (le vin rare, le bébé précieux).
– Effet littéraire : Cela donne une impression de chaleur, d’intimité, de tradition, voire de rituel. Le moïse protège la bouteille comme il protégerait un enfant.
Pour aller plus loin dans l’analyse
Si tu veux exploiter cette image dans un atelier d’écriture ou dans un texte à toi, tu peux jouer sur plusieurs niveaux :
– La métaphore filée : Le moïse devient le berceau du vin, le vin devient un enfant précieux, fragile, qu’on dévoile avec respect.
– L’ambiance : Le côté sombre et poussiéreux évoque un objet ancien, caché, oublié, mais qui recèle un trésor.
– Le choix du mot : « Moïse » sonne plus poétique, plus rare, que « panier en osier », et il ouvre la porte à des jeux de mots ou à des références bibliques ou mythologiques.
Mon avis
J’aime beaucoup cette image. Elle crée une atmosphère particulière, à la fois précise et mystérieuse. Le moïse, par son nom, apporte une touche d’histoire, de légende, et de douceur. C’est une belle façon de transformer un objet banal – une bouteille de vin – en personnage de roman, en objet de désir ou de mémoire.
Question à l’IA : C’est dans la traduction de « Et vive l’aspidistra ! »
Réponse de l’IA Perplexity : Merci pour la précision, Francis. Tu fais référence à la traduction française du roman « Keep the Aspidistra Flying » de George Orwell, intitulée en français « Et vive l’aspidistra ! ». L’extrait que tu cites, « une bouteille de vin sombre et poussiéreuse dans son moïse », s’y trouve effectivement, et il mérite qu’on s’y attarde, tant sur le plan du vocabulaire que sur celui de la traduction littéraire.
Le « moïse » dans la traduction de « Et vive l’aspidistra ! »
Origine et usage du terme
Dans la traduction française, le mot « moïse » désigne, comme évoqué plus haut, un panier en osier, souvent utilisé pour transporter un bébé, en référence à l’histoire biblique de Moïse. Mais dans le contexte de la bouteille de vin, il s’agit d’un usage métaphorique et un peu suranné du terme, qui évoque un contenant d’osier destiné à protéger et transporter la bouteille (souvent les bouteilles de vin anciennes ou précieuses étaient enveloppées ou calées dans de tels paniers pour éviter la casse).
Traduction et choix du mot
Dans le texte original d’Orwell, la phrase correspondante est :
« a dark, dusty bottle in its basket »
Le traducteur a choisi d’employer « moïse » pour rendre « basket », ce qui donne à la phrase une coloration particulière, à la fois poétique et légèrement archaïque. Là où l’anglais reste neutre (« basket »), le français, par ce choix, ajoute une couche de sens, une aura de mystère, de tendresse, et même une pointe d’humour involontaire, car le lecteur inattentif pourrait croire à une bizarrerie ou à une invention de l’auteur.
Effet produit sur le lecteur
Ce choix de traduction n’est pas anodin :
– Il confère à la bouteille un statut quasi sacré, comme si elle était un nourrisson à préserver.
– Il introduit une note d’intimité, de soin, de tradition, qui s’accorde bien avec l’atmosphère du roman, où le personnage principal, Gordon Comstock, oscille entre la misère, la nostalgie et la recherche d’une forme de pureté ou d’authenticité.
– Il donne à la scène une texture sensorielle : on imagine la poussière, l’osier, le verre épais, tout un univers tactile et olfactif.
Mon opinion sur ce choix
À mon sens, ce genre de détour lexical dans la traduction est une réussite, car il enrichit la phrase d’une dimension supplémentaire. Là où l’anglais se contente de l’utilitaire, le français, par le biais du « moïse », convoque tout un imaginaire, une tradition, une tendresse discrète. C’est un exemple frappant de la manière dont la traduction peut, par un simple mot, transformer la matière première du texte et lui donner une résonance nouvelle.
En somme, dans « Et vive l’aspidistra ! », le « moïse » de la bouteille de vin est un panier en osier, mais il est aussi, par la grâce de la traduction, un petit miracle d’évocation. Un mot rare, pour une image qui ne l’est pas moins.
Q : Plus loin dans le roman se trouve un terme qui m’est inconnu : « Pourquoi faut-il lorsqu’on n’a pas d’argent, privé prémentcisé de cela ? ». Prémentcisé ?
Réponse de l’IA Perplexity : Francis, tu mets le doigt sur un mot qui, à première vue, semble relever de la coquille typographique, de l’hapax involontaire ou d’une invention lexicale étrange. Le terme **« prémentcisé »** n’existe pas dans le dictionnaire de la langue française, ni dans les usages littéraires classiques ni dans l’argot ou les régionalismes connus. Il intrigue, il déroute, il invite à la perplexité.
Hypothèses sur « prémentcisé »
1. Erreur typographique ou coquille d’impression
La piste la plus probable est celle d’une coquille. Dans le contexte de la phrase :
> « pourquoi faut-il, parce qu’on n’a pas d’argent, privé prémentcisé de cela ? »
On s’attendrait à un adjectif ou à un participe passé qui qualifierait le fait d’être privé de quelque chose. Or, « prémentcisé » ne correspond à rien de connu. Il est possible qu’il s’agisse d’une déformation ou d’une contraction accidentelle de deux mots, ou d’une mauvaise lecture lors de la composition du texte.
2. Mot-valise ou néologisme involontaire
On pourrait imaginer un mot-valise, une tentative de fusion entre « prémuni » et « précisé », mais cela n’a guère de sens dans le contexte. Aucun mot courant ne s’approche vraiment de cette forme.
3. Mauvaise transcription ou traduction
Il est possible que le texte original anglais comportait une nuance particulière, que le traducteur a voulu rendre d’une manière spécifique, mais qu’une erreur s’est glissée à l’impression ou à la relecture.
Dans le texte anglais, on trouve :
> “Why should one be deprived of it just because one has no money?”
On voit que la phrase est plus simple, sans adjectif supplémentaire.
4. Hypothèse sur le sens
Si l’on tente de donner un sens à « prémentcisé » en le découpant, on pourrait penser à « prématurément » ou « précisément », mais la syntaxe ne colle pas. Peut-être le texte voulait-il dire « privé prématurément de cela », ou « privé précisément de cela », et qu’une faute de frappe a accouché de ce mot étrange.
Mon opinion
Je penche très nettement pour une « coquille ». Il est probable que le texte original ou une version antérieure comportait « prématurément » ou « précisément », et qu’une erreur de composition ou de saisie a donné naissance à ce « prémentcisé » fantomatique. Il s’agit d’un accident typographique, non d’un mot à sens caché ou d’un archaïsme.
En résumé
– « Prémentcisé » n’existe pas dans la langue française.
– Il s’agit très probablement d’une coquille typographique, sans doute pour « prématurément » ou « précisément ».
– Le texte original anglais ne comporte pas cette complexité.